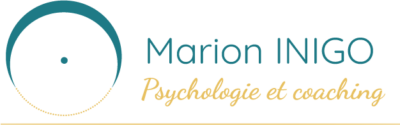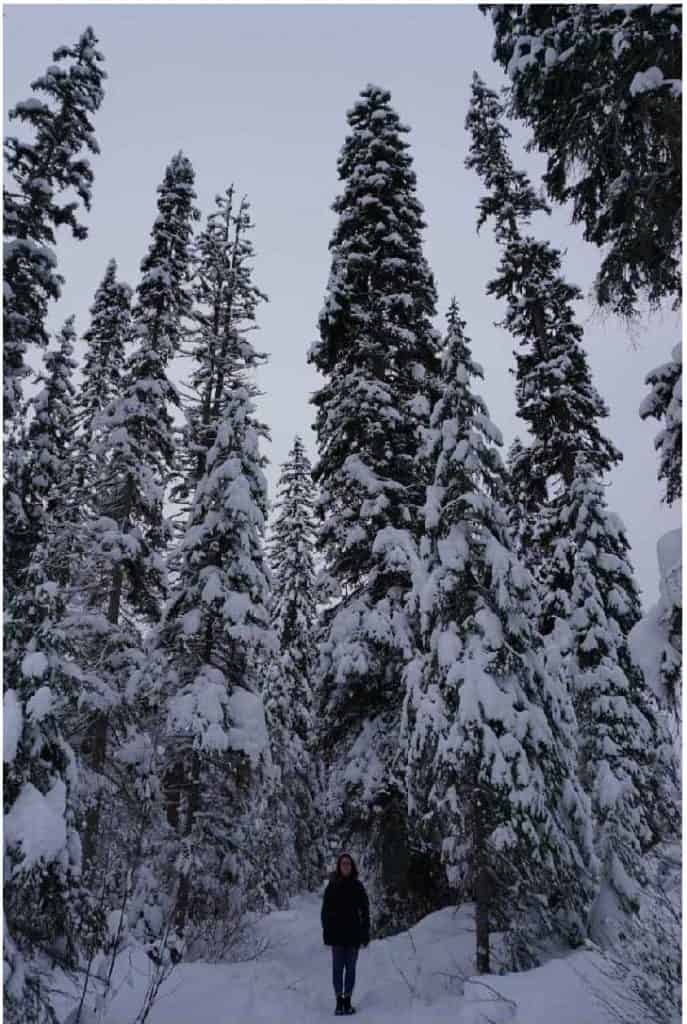FONCTIONNEMENT DE SOI, DE SON EGO
Temps de lecture de l’article « Fonctionnement de soi, de son égo » : 5min
Cet article aborde le fonctionnement de soi, de notre égo. En lisant ces lignes, j’espère que vous apprendrez à mieux vous comprendre et à prendre soin de vous.
Comment définir le "soi" ?
Le « soi » est une partie de nous qui constitue notre identité, notre capacité à dire « je pense » (moi ici et maintenant) et à nous définir « je suis cette personne » (Ricard, 2013). Il existe d’autres manières de le concevoir et ça sera l’objet d’un article (l’égo pur ou notre état de conscience universelle – à venir). Mais pour l’instant focalisons nous sur comment nous nous définissons.
Nous nous définissons principalement par rapport à notre vécu, nos expériences, nos attentes et les autres personnes. Elles peuvent stabiliser certaines croyances ou plus précisément, d’attributions de la réalité. On peut s’en rendre compte dans le langage par des expressions telles que « je suis comme ça, on n’y peut rien » ou bien « c’est tous des colériques dans ma famille, donc moi aussi » etc… Ces constructions de pensée peuvent être négatives, mais bonne nouvelle, aussi positives ! Dans les deux cas, il convient de prendre conscience que ce sont des constructions !
Toute construction peut être déconstruite
Ce n’est pas parce qu’un jour vous avez fait quelque chose que vous considérez comme mal que vous êtes une mauvaise personne ou que vous avez échoué dans un domaine que vous allez échouer pour le restant de vos jours !
« Tout est changement, non pour ne plus être mais pour devenir ce qui n’est pas encore »
Épictète
Consultations en visio et en cabinet
Fonctionnement de soi, de son égo : l'influence de la culture
Dans notre culture occidentale, il est valorisé d’avoir une personnalité stable, indépendante des autres et catégorisable (Markus & Kitayama, 1998). Cette manière de définir l’identité influence fortement nos aspirations, nos motivations en nous ancrant dans un mode de fonctionnement individualiste et centré sur la réussite sociale. Malheureusement lorsqu’on est trop attaché aux réussites le bonheur n’est pas stable. Nous pouvons avoir des comportements altruistes qui conduisent à avoir un bonheur plus durable (Dambrun et al., 2013, voir l’article sur le bonheur durable).
Nous pouvons être individualiste et altruiste
Prendre conscience de cette complexité peut nous amener à calmer les jugements qu’on porte sur nous-même et sur les autres. Les relations qu’on a avec les personnes qui entrent dans notre vie peuvent être source de tensions, de conflits et de toutes sortes d’incompréhension. Les problèmes qu’on rencontre sont souvent dus à un déséquilibre entre l’écoute de nos besoins personnels (être plutôt individualiste) et ceux des autres (être plutôt altruiste).
Il est important de trouver l’équilibre entre ses besoins et ceux des autres. Dans le cas où on commence à être trop individualiste on prend le risque de perdre des relations sociales et de développer un sentiment de solitude très fort. Dans le cas inverse, où on fait passer toujours les besoins des autres avant les siens, le risque est de se perdre soi-même, ses aspirations, mais également de souffrir d’un sentiment de solitude lorsqu’on est face à soi.
Tout est question d’équilibre. Pensez à vous et aux autres, la vie vous remerciera !
La leçon à tirer de cet article est d’apprendre à connaître ses besoins.
Quels sont-ils ? Sont-ils satisfaits ? Est-ce que je me sens bien dans ma tête ?
C'est en s'aidant soi-même qu'on peut réellement aider les autres !

Consultations en visio et en cabinet
Des références sur le fonctionnement de soi, de son égo
Dambrun, M., Ricard, M., Desprès, G., Drelon, E., Gibelin, E., et al., (2012). Measuring happiness: from fluctuating happiness to authentic–durable happiness. Frontiers in psychology, 3, 16.
Markus, H. R., & Kitayama, S. (1998). The cultural psychology of personality. Journal of cross-cultural psychology, 29, 63-87.
Ricard, M. (2013). A Buddhist View of Happiness. In Oxford Handbook of Happiness (pp. 344-356). Oxford : Oxford University Press.